Quand l’intelligence artificielle devient levier éducatif : vers une révolution pédagogique durable en Afrique de l’Est
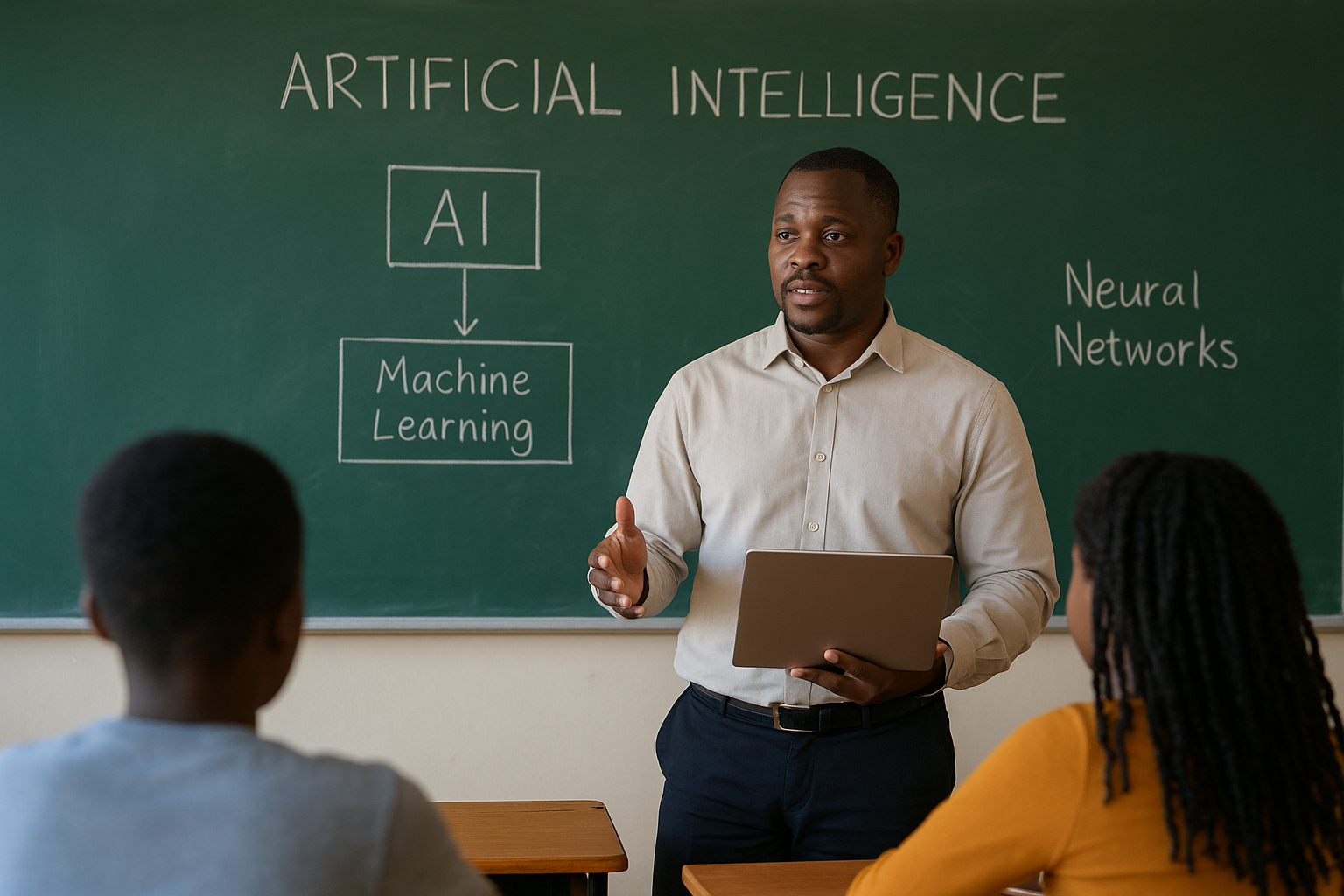
Dans cet article nous essayons d'analyser la situation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Est, marqués depuis des décennies par des réformes coûteuses et largement financées par des partenaires extérieurs, mais souvent déconnectées des réalités du terrain. Malgré les milliards investis, les problèmes persistent : faible niveau des élèves, manque de formation des enseignants, salaires précaires, infrastructures insuffisantes et pénurie de manuels scolaires.
Face à cette impasse, nous proposons une alternative : l'intégration des intelligences artificielles génératives (IAG) dans les pratiques pédagogiques. Loin de remplacer les enseignant.e.s, ces outils peuvent les accompagner dans la préparation des cours, la personnalisation des apprentissages et l'évaluation des élèves, tout en coûtant moins cher que les réformes traditionnelles.
L'article plaide pour une synergie régionale entre les 18 pays d'Afrique de l'Est, la création d'outils d'IA adaptés aux réalités locales et l'investissement dans la formation des jeunes aux métiers de l'IA. Il conclut qu'une véritable autonomie éducative ne pourra se construire que si l'Afrique s'approprie ces technologies émergentes au lieu de dépendre éternellement des fonds étrangers.
À propos de l'auteur
Nour Fahad est un professionnel reconnu dans le domaine de l'éducation et de la coopération éducative. Fort d'une solide expérience dans le pilotage de projets, l'accompagnement des familles et la collaboration avec des acteurs institutionnels et associatifs, il s'impose comme une voix incontournable sur les questions éducatives. Il est enseignants, expert en élaboration de politiques publiques et en parentalité. Il conjugue innovation pédagogique et coopération internationale pour repenser l'école de demain.
Pour citer cet article : Nour Fahad, (2025). Quand l'intelligence artificielle devient levier éducatif : vers une révolution pédagogique durable en Afrique de l'Est . #ComoresTice- RCRIE
Droit d'auteur :
©Tous droits réservés, dans tous les pays.
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, la copie ou la reproduction de cet article à des fins collectives est strictement interdite. Toute citation, qu'elle soit partielle ou intégrale, doit obligatoirement mentionner le nom de l'auteur.
Toute reproduction, modification ou réécriture de cet article, par quelque procédé que ce soit, sans l'accord préalable de l'auteur ou de ses ayants droit, est considérée comme illicite. Cela constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Introduction
Si l'intelligence artificielle ne saurait substituer l'expérience incorporée du véritable professionnel, celui qui refuse de s'approprier les nouveaux instruments de production symbolique qu'elle représente s'expose à devenir, non pas le garant d'un savoir authentique, mais l'agent obsolète d'un ordre en déclin. Dans un champ professionnel en mutation rapide, l'ignorance technologique cesse d'être un acte de résistance pour devenir une forme d'auto-marginalisation. (Nour Fahad, 2024)
Cette citation, qui sonne comme un avertissement, ouvre un horizon de réflexion : celui des transformations profondes que l'intelligence artificielle (IA) impose aux professions, et plus particulièrement à celle d'enseignant. Alors que l'IA suscite des débats mondiaux, les systèmes éducatifs d'Afrique de l'Est demeurent englués dans des réformes successives, souvent coûteuses et peu adaptées aux réalités locales. Depuis plusieurs décennies, des milliards d'euros ont été investis dans la formation des enseignant.es, la révision des programmes et l'amélioration des infrastructures. Pourtant, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Dans ce contexte, l'irruption des IA génératives représente moins une menace qu'une opportunité pour repenser les pratiques enseignantes et bâtir une souveraineté éducative africaine.
1. L'Afrique de l'Est face à l'impasse des réformes éducatives coûteuses
Au cours des vingt dernières années, plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont bénéficié de financements massifs de la part de bailleurs internationaux. Le Kenya, par exemple, consacre aujourd'hui près de 28 % de son budget national à l'éducation, soit plus de 700 milliards de shillings kényans pour l'année 2025/2026 (MEN Kenya 2025), dont 387 milliards destinés uniquement à la rémunération et à la formation des enseignant.es. (Teachers Service Commission allocation, 2025.) Malgré ces efforts, les enseignant.es restent souvent débordés par des classes surchargées, et le déploiement du nouveau curriculum basé sur les compétences (CBC) se heurte à des difficultés d'appropriation.
En Ouganda, un rapport conjoint du gouvernement et de la Banque mondiale estime que pour atteindre une éducation de qualité d'ici 2040, il faudrait augmenter le budget éducatif de 440 %, doubler le nombre d'enseignants, quadrupler les infrastructures et multiplier par quatre la production de manuels scolaires. (Banque mondiale, 2025). Dans certaines régions rurales, le ratio élèves/enseignant atteint 100:1, un chiffre qui illustre l'ampleur des défis structurels.
Quant à la Tanzanie, avec son Programme de développement de l'éducation primaire (PEDP, 2002–2009), financé notamment par la Banque mondiale (150 millions USD) et les Pays-Bas (50 millions USD), avait pour ambition d'améliorer l'accès et la qualité à l'école primaire (Banque mondiale, 2002). Mais les évaluations ont montré que si l'accès s'est effectivement élargi, la qualité des apprentissages reste faible, notamment dans les zones rurales, où manquent à la fois manuels et enseignants qualifiés.
L'archipel des Comores n'a pas échappé à ces réformes couteuses depuis le début des années 1990. En effet, les États généraux de l'éducation et de la formation, lancés en 1994, ont jeté les bases d'une nouvelle école comorienne, concrétisées par l'élaboration d'un Plan directeur de l'éducation en 1996. Ces États généraux avaient pour objectif principal d'établir un diagnostic des problèmes de l'école comorienne, tels que la massification des élèves et le manque d'enseignants qualifiés (M. Ridhoine, 2024). Plusieurs projets de réformes (tels que l'Éducation pour tous au primaire en 2005 ou l'amélioration des compétences de base des élèves en 2010) ainsi que des évaluations menées par l'UNESCO, l'UNICEF ou le PASEC ont porté sur la qualité de l'enseignement primaire. Les résultats révèlent un faible niveau des élèves, notamment en lecture, en écriture et surtout en mathématiques, avec des scores souvent inférieurs à la moitié des compétences attendues, et ce malgré plus de 146 milliards de dollars investis dans le système scolaire comorien au cours des dix dernières années.
Enfin, au Rwanda, des recherches récentes soulignent un taux élevé de rotation du personnel enseignant : près de 20 % des enseignants quittent le métier chaque année, dont une partie vers d'autres secteurs mieux rémunérés. À peine 77 % des départs sont remplacés, ce qui provoque une baisse mesurable des performances scolaires des élèves, estimée à environ 0,05 écart-type dans les classes concernées (R. Crawfurd et al, 2022).
Ces exemples, bien documentés par la recherche en sciences sociales et en économie de l'éducation, révèlent un paradoxe : malgré des financements massifs, les systèmes éducatifs de la région peinent à se stabiliser et à offrir une éducation de qualité.
2. Dépendance financière et fragilité structurelle des systèmes éducatifs
Ces réformes, en grande partie financées par l'Union européenne, la Banque mondiale ou d'autres partenaires internationaux, soulèvent une question centrale : peut-on bâtir un système éducatif durable en dépendant essentiellement de financements extérieurs ?
Les sciences sociales montrent que cette dépendance crée une fragilité structurelle : les politiques éducatives s'alignent sur les agendas des bailleurs, souvent guidés par des objectifs macroéconomiques ou diplomatiques, plutôt que par une compréhension fine des réalités locales. Cette situation entretient ce que l'on pourrait qualifier de « grand théorisme » : des réformes rédigées dans un langage technocratique, présentées comme des solutions universelles, mais qui peinent à s'ancrer dans les pratiques quotidiennes des écoles (P. Altbach, 2016).
Un système scolaire dépendant structurellement de ressources extérieures ne peut durablement se consolider. Au contraire, il tend à entretenir une logique de dépendance, freinant l'innovation locale et marginalisant les initiatives endogènes.
3. L'irruption de l'intelligence artificielle générative : menace ou opportunité ?
C'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle générative apparaît. Définie comme un ensemble de systèmes capables de produire du texte, des images, des exercices ou encore des scénarios pédagogiques à partir de larges corpus de données, elle représente un tournant dans la manière de concevoir et de diffuser le savoir.
Pédagogiquement, ces outils offrent la possibilité de créer rapidement des supports adaptés aux contextes linguistiques et culturels, de générer des exercices différenciés en fonction des niveaux, ou encore de proposer des outils d'évaluation automatisés. Sociologiquement, l'IA générative reconfigure le rapport à la connaissance : l'enseignant n'est plus seulement transmetteur, il devient médiateur, accompagnateur critique face à des productions générées automatiquement.
Certes, l'usage de ces outils soulève des questions éthiques : respect des données personnelles, transparence des algorithmes, risque de dépendance aux plateformes technologiques dominantes, souvent situées en dehors du continent africain (UNESCO, 2023). Mais ces risques ne doivent pas masquer l'opportunité : celle de bâtir une pédagogie africaine augmentée, ancrée dans les besoins locaux et utilisant des instruments technologiques puissants.
4. Pistes pour une appropriation locale et collective de l'IA en Afrique de l'Est
L'une des premières urgences consiste à penser collectivement l'intégration de l'IA à l'échelle régionale. Une synergie entre les 18 pays d'Afrique de l'Est permettrait de mutualiser les ressources, de développer des programmes conjoints de formation pour les enseignant.es, et de partager des bases de données éducatives adaptées aux réalités locales.
La deuxième piste est celle de la contextualisation. Les IA génératives existantes sont souvent conçues à partir de corpus occidentaux, dans des langues dominantes comme l'anglais ou le français. Adapter ces outils aux langues africaines, aux réalités culturelles et aux besoins pédagogiques spécifiques (par exemple, gérer une classe de 60 élèves avec peu de matériel) est essentiel. On peut imaginer des IA capables de produire des exercices en kiswahili, en amharique, en comorien ou en kinyarwanda, ou encore de générer des manuels numériques adaptés aux programmes locaux.
La troisième piste consiste à former la communauté éducative : enseignants, élèves, parents. Trop souvent, les technologies éducatives sont introduites sans accompagnement, ce qui conduit à un rejet ou à une utilisation superficielle. Une appropriation critique et raisonnée de l'IA, intégrée aux pratiques pédagogiques, permettrait de transformer réellement la relation à l'apprentissage.
Enfin, il est indispensable d'engager la jeunesse africaine vers les métiers de l'IA. Sans formation locale, l'Afrique de l'Est restera dépendante de solutions importées. Encourager les jeunes à se former à l'IA, à développer des modèles africains, constitue un investissement stratégique pour l'avenir éducatif et technologique de la région.
Conclusion
Refuser de s'approprier l'IA générative, c'est risquer l'obsolescence, comme le souligne notre citation placée en ouverture. L'Afrique de l'Est ne peut continuer à investir des milliards de dollars dans des réformes éducatives qui échouent à répondre aux réalités du terrain. L'IA, bien encadrée, peut offrir des solutions moins coûteuses, plus flexibles et mieux adaptées. Elle ne remplacera jamais l'expérience et la présence humaine de l'enseignant.e, mais elle peut l'outiller, le soutenir et renforcer son rôle de guide dans un monde où la connaissance circule à une vitesse inédite.
Le temps est venu pour les ministères de l'éducation des pays d'Afrique de l'Est de dépasser la dépendance aux financements extérieurs et de miser sur une souveraineté éducative numérique. L'IA ne doit pas être vue comme une menace importée, mais comme une chance d'inventer une pédagogie africaine renouvelée, plus proche des besoins réels et plus ambitieuse dans ses horizons.
Références bibliographiques
Banque mondiale(2002) Primary Education Development Programme (PEDP), Gouvernement tanzanien.
Banque mondiale(2025) Uganda's education sector needs 440% budget increase. Rapport conjoint Pays.
Eastleigh Voice ( 2025). Kenya to spend Sh980 million on teacher retooling for CBC.
MEN Kenya (2025). Education Budget 2025/26.Education News Kenya.
Mouhamadi Ridhoine,(2024). Évolutions, qualités et contraintes du système éducatif de l'Union des Comores , Revue internationale d'éducation de Sèvres.
Nour Fahad (2025). La place de l'IAG dans les pratiques enseignantes au 21e siècle. #ComoresTice.
P. Altbach, (2016° Global perspectives on higher education, Johns Hopkins University Press.
R. Crawfurd et al (2020), Teacher turnover and student learning in Rwanda, IZA Discussion Paper.
UNESCO, (2023) ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education: Quick Start Guide, Paris.
